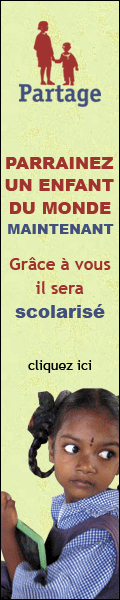Après de longs mois d’absence sur La Lettrine, me voici de retour. De nombreux projets ont conduit à cet éloignement : l’édition, l’enseignement spécialisé auprès de jeunes handicapés moteurs, différentes fonctions au rectorat. Et surtout, je dois l’avouer, un peu de lassitude… Le monde de la blogosphère a bien évolué depuis ses débuts et il m’a manqué d’énergie pour surnager parmi l’offre très riche proposée aujourd’hui.
Après de longs mois d’absence sur La Lettrine, me voici de retour. De nombreux projets ont conduit à cet éloignement : l’édition, l’enseignement spécialisé auprès de jeunes handicapés moteurs, différentes fonctions au rectorat. Et surtout, je dois l’avouer, un peu de lassitude… Le monde de la blogosphère a bien évolué depuis ses débuts et il m’a manqué d’énergie pour surnager parmi l’offre très riche proposée aujourd’hui.
Mais venons-en au cœur du sujet : la rentrée littéraire. D’emblée, elle semble plutôt « classique ». On retrouve les auteurs phares comme Emmanuel Carrère, l’immanquable Amélie Nothomb, Olivier Adam, Jean-Marie Blas de Roblès… On voit se profiler les listes des prix littéraires de cet automne. On observe les couvertures des différents magazines littéraires où sont mis à l’honneur ces auteurs. La part belle est faite à Emmanuel Carrère qui semble être le favori de cette rentrée. Il est à la Une du Magazine littéraire et de Lire, les médias, pour la plupart, le désignent comme l’auteur à lire en cette rentrée. Qu’à cela ne tienne : j’ai lu Le Royaume d’Emmanuel Carrère (chez POL).
Disons-le tout de suite : je suis partie avec un a priori positif. J’aime beaucoup Carrère, que ce soit ses fictions comme La Moustache ou La Classe de neige, comme ses récits personnels comme L’Adversaire ou Un roman russe (qui m’avait bouleversée). Un défaut m’agace pourtant dans ses textes, c’est son ton supérieur, ce besoin de répéter à l’envi qu’il appartient à un milieu intellectuel l’autorisant à regarder ses congénères avec un certain mépris. Je me souviens d’un passage d’Un roman russe qui m’avait particulièrement irritée : à l’époque, il était en couple avec une certaine Sophie qui n’appartenait visiblement pas à son milieu. Lors de dîners avec des amis cinéastes, journalistes, écrivains, Carrère se plaisait à échanger des points de vue sur des œuvres majeures avec la tablée. Parce qu’elle ne les connaissait pas et pour paraître moins stupide à l’avenir, la jeune femme avait pris l’habitude de noter ces œuvres et de les consulter. Or, au lieu de percevoir ce geste comme le désir de vouloir s’élever intellectuellement, Carrère au contraire le trouvait ridicule. Précisément, on retrouve ce travers dans Le Royaume.
Quel est le rapport entre ce travers et Le Royaume ? Vous avez dû lire partout que ce texte est une enquête sur l’histoire du début du christianisme et pour le moment, je reste focalisée sur Carrère et ses petits défauts. Justement : la première partie du livre peut dérouter car il n’est question que de lui, ses crises d’angoisse, ses phases de dépression et la découverte, en 1990, de la foi. Le « je » domine très largement ces pages où l’on apprend comment, alors qu’il est issu d’une famille plutôt éloignée de la religion, il a été amené, pendant trois années, à se rendre quotidiennement à la messe et à étudier avec une certaine maniaquerie l’Evangile de Luc et les épîtres de Paul. Chaque jour, en guise d’exercice, il note ses réflexions sur ses lectures bibliques. Les années passent, loin de l’église et de ces considérations sur Dieu. Tandis qu’il écrit le scénario pour une série télévisée, Les Revenants, où les morts ressuscitent, il se demande comment l’on peut croire à ce genre de miracle, ce qu’est la foi. Il décide donc dans un premier temps d’enquêter sur les Chrétiens et d’aller vers ces fidèles pour mieux les comprendre. Finalement, parce qu’il est le meilleur de ses sujets littéraires, il se rappelle de sa propre crise de foi remontant à plus de vingt ans. Il retrouve ses cahiers et ses notes de lecture et décide de les reprendre afin de mener une véritable enquête sur les débuts du Christianisme. On entre alors dans les trois autres parties du livre.
A ce moment-là, on a presque envie d’abandonner. On ne comprend pas bien la cohérence du livre : le ton change, Carrère semble s’effacer derrière ses exégètes, et surtout fait des analogies quelque peu farfelues, pour rendre cette époque plus proche de la nôtre. Il évoque Mel Gibson, Ben Laden, les Bolcheviques, Poutine, , Lucky Luke… Mais ces rapprochements m’ont souvent paru hors de propos. Deux personnages, témoins des premiers temps du christianisme sont cependant au cœur de ce projet : Luc et Paul. C’est grâce à eux que Carrère dépeint cette époque. Il se sent d’ailleurs particulièrement proche de Luc qui, comme lui, a la volonté se s’adresser aux croyants comme aux autres ; moins de Paul, si fanatique qu’il le compare dans sa démarche à Ben Laden.
Si tous ces récits m’ont moins plu, encore que j’ai dévoré les chapitres consacrés à Rome, j’ai cependant été très intéressée par son cheminement intellectuel, les liens qu’il tisse avec ses textes passés. A plusieurs reprises, par exemple, il revient sur son récit L’Adversaire, racontant le quotidien du mythomane Jean-Claude Romand. Cet homme l’a profondément marqué non seulement à cause de son acte (il a préféré tuer toute sa famille au lieu d’avouer ses mensonges) mais aussi de sa foi (il prierait quotidiennement en prison). Pour Carrère, Romand devrait entrer au Royaume des cieux puisqu’il représente l’humble, la brebis égarée, le paria. On comprend peu à peu le projet du Royaume, même si c’est au prix d’une lecture parfois fastidieuse : trouver une cohérence dans son œuvre. Et, effectivement, comme dans Un roman russe, l’épilogue justifie l’ensemble. Dans les dernières pages, il accepte de se rendre dans une association L’Arche, accueillant des personnes handicapées pour y tenter une expérience : laver et se faire laver les pieds comme Jésus avait l’habitude de le faire. Pour Carrère, ce moment est spirituel mais la journée se clôt sur un sentiment de gêne : les gens ainsi réunis se retrouvent à chanter « Jésus est mon ami ». Carrère n’a pas envie de se mêler à tous ces gens jusqu’au moment où une petite fille, trisomique, le regarde avec un sourire plein de naïveté et de joie de vivre. Il se laisse aller à la liesse générale et oublie ses préjugés. Le livre se termine sur la notion de fidélité : même s’il n’est plus l’homme qu’il fut pendant trois ans, il a écrit ce récit avec toute la bonne foi dont il est capable. Même si je n’ai pas été convaincue par ce livre dans son ensemble, je ne regrette pas de l’avoir lu car la quête existentielle de Carrère semble sincère. J’aurais aimé cependant plus de simplicité et une écriture, sans doute, plus soutenue.












 A
A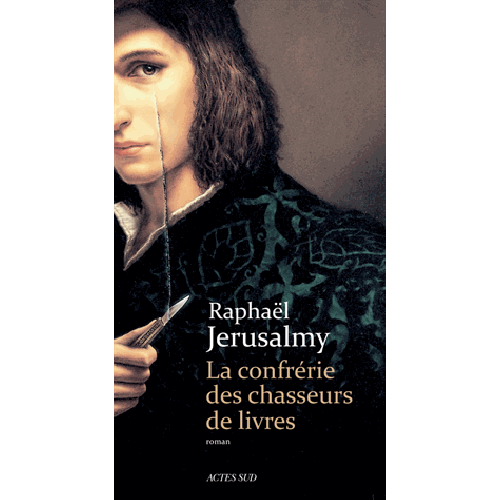 S
S J
J J
J P
P M
M L
L F
F