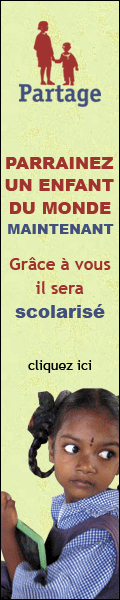Rencontre à Paris, avec Johan Harstad accompagné de son attachée de presse et de son traducteur, dans un café de la rue Mouffetard. L’auteur du fabuleux Buzz Aldrin, mais où donc es-tu passé ? a quelque chose de Mattias : timide, regard fuyant, on sent au premier abord qu’il n’est pas forcément très à son aise. Et puis l’entretien commence et il se laisse aller. La complicité qu’il a avec son traducteur, Jean-Baptiste Coursaud, facilite l’échange. Je garde un excellent souvenir de ce moment passé trop vite avec un auteur qui mérite d’être lu.
Rencontre à Paris, avec Johan Harstad accompagné de son attachée de presse et de son traducteur, dans un café de la rue Mouffetard. L’auteur du fabuleux Buzz Aldrin, mais où donc es-tu passé ? a quelque chose de Mattias : timide, regard fuyant, on sent au premier abord qu’il n’est pas forcément très à son aise. Et puis l’entretien commence et il se laisse aller. La complicité qu’il a avec son traducteur, Jean-Baptiste Coursaud, facilite l’échange. Je garde un excellent souvenir de ce moment passé trop vite avec un auteur qui mérite d’être lu.
Buzz Aldrin est le fil conducteur dans ce roman. D’où vous vient cette fascination pour celui qui fut le deuxième à marcher sur la lune ?
J’ai toujours été fasciné par les numéros 2, pas les meilleurs mais ceux qui arrivent juste après. Et de tous, c’est Buzz Aldrin le plus connu. J’ai fait énormément de recherches sur lui : j’ai lu des livres, j’ai compulsé, amassé des documents qui existaient sur lui.
Quelle a été votre formation ?
J’ai commencé des études de littérature et de sciences des médias mais j’ai abandonné. Si j’ai fait ces études c’était uniquement pour bénéficier du prêt que l’on accorde aux étudiants norvégiens. Une partie est une bourse, l’autre est à rembourser. Je bénéficiais d'un prêt ce qui me permettait de continuer d’écrire.
Vous avez toujours voulu écrire ?
Oui, j’écris depuis l’âge de 11-12 ans et dès l’âge de 15 ans j’ai su que je serai écrivain.
Je vous ai demandé votre cursus parce que dans votre roman la psychologie est fortement présente. Les personnages des îles Féroé habitent dans une résidence psychiatrique et Mattias lit les diagnostics très précis des uns et des autres. Il me semblait donc que vous aviez étudié la psychologie.
Je suis ravi de l’entendre parce que ça veut dire que j’ai bien lu. Pour écrire ce passage j’ai lu un livre de 900 pages qui s’appelle Manuel de psychiatrie. Mais je n’ai pas du tout fait d’études dans ce domaine.
Mattias est également un personnage complexe, dépressif qui aspire à une autre vie…
C’est dû au fait que je me suis toujours intéressé à la psychiatrie et j’ai fait énormément de recherches pour l’écriture de ce roman.
Comment vous est venu l’idée d’introduire, dans le dernier quart du roman, un nouveau personnage, qui a fait la guerre en Bosnie, et qui lui aussi tombe en dépression après avoir fait différents actes héroïques ?
Il y a différentes raisons. D’abord quand j’écris un roman, je fais toujours un plan très précis. Tout est soigneusement composé et puis parfois on a un peu de chances. Au départ, le personnage de Carl était celui qui était le moins développé dans ce schéma que j’avais élaboré. Donc à un moment donné je l’ai introduit dans le récit en me disant, on va voir ce qui va se passer. Au début, je pensais qu’il n’aurait qu’un rôle secondaire et au final je suis très satisfait de voir l’ampleur qu’il a pris dans le récit.
En effet, ce personnage est très important : il est le point d’orgue dans la série de ces personnages qui veulent rester seconds.
On peut même dire qu’il intervient au plus mauvais moment d’un point de vue dramaturgique au point que mon éditrice m’avait dit « non non tu ne peux pas mettre ça, c’est beaucoup trop tard ». Mais moi, j’ai suivi mon idée et je pense qu’il intervient au bon moment. On apprend son passé au moment où les personnages n’ont vraiment pas besoin d’apprendre encore une mauvaise nouvelle. Ils en ont eu assez comme ça. Cette mauvaise nouvelle supplémentaire a au final son importance puisqu’elle oblige les autres à se sauver les uns les autres. Il faut qu’ils se soutiennent dans cette entreprise et cette mauvaise nouvelle va les renforcer dans cette nécessité.
Votre roman dénonce une société basée sur la réussite. Aviez-vous eu envie de montrer l’envers du décor au travers le destin de ces différents personnages ?
Ce n’est pas un roman qui s’insurge contre les gens. Chacun vit comme il veut. Et même ces gens qui veulent à tout prix réussir doivent être respectés. C’est davantage un roman qui prend la défense des gens qui veulent vivre autrement. Au début je voulais vraiment construire un roman autour d’un personnage que je considérais comme unique. Unique dans le sens où il n’y avait que lui qui ne voulait pas aller dans la lumière, qui voulait rester anonyme. Et puis je me suis rendu compte au fur et à mesure de l’écriture de ce roman qu’il y a plein de gens, comme lui, qui veulent garder leur anonymat. Je pense qu’on a tous ce désir en nous d’être vus, reconnus et de connaître le succès et en même temps le désir de ne pas être vus. Je pense que le roman est aussi une défense de ces gens qui ne sont pas dans les premiers rangs, qui ne sont pas dans la lumière et qui ont compris qu’ils ont leur place dans l’existence. J’ai travaillé plusieurs étés en tant que fossoyeur dans un cimetière, en tant que éboueur... Ca m’a permis de rencontrer tout un tas de gens qui ont des vies extrêmement riches en fait. Ca va être une évidence ce que je vais dire mais moi je pense véritablement à tous ces gens qui sont des silhouettes de leur propre vie et qui n’ont pas l’impression d’avoir de l’importance alors qu’ils en ont une.
Vous avez choisi de placer le décor de votre roman aux îles Féroé. Est-ce pour son côté refuge ?
Les îles Féroé font en effet un peu office de foyer. C’est un lieu à la fois où rien ne se passe et en même temps c’est une micro société. Donc, si je devais décrire cette vie quotidienne féroïenne, je décrirais des personnes qui vont travailler dans le journal féroïen qui est lu par 5 000 personnes, je montrerais des gens en train de tondre leurs moutons ou de pécher. Et voilà, on aurait fait le tour… Et ça serait très vite très ennuyeux. J’ai passé pas mal de temps aux Féroé et il est certain que si je devais décrire le quotidien féroïen, ça revient un peu à regarder l’herbe pousser. Vous regardez une journée passer, une deuxième journée… Et il ne s’est pas passé grand chose. Chaque jour, le quotidien féroïen est une copie du précédent.
Plus sérieusement, j’ai choisi les Féroé parce que dans un contexte nordique les îles Féroé c’est non seulement le l’incarnation du numéro 2 par rapport aux autres pays du Nord et c’est surtout un vrai numéro 2 par rapport à l’Islande. Enfin, les Féroé offrent un paysage très lunaire.
La figure de Robinson Crusoé revient souvent au cours du récit. Y a-t-il d’autres figures aussi emblématiques qui vous ont inspiré ?
Je pense que parmi les personnages emblématiques il y a effectivement Robinson Crusoé puisque mon rêve a toujours été d’échouer sur une île déserte, de me débrouiller tout seul. Et l’autre est une chanson de Radiohead : « How to disappear completely ».
C’est un détail mais vous faites référence à un auteur norvégien que nous avons découvert l’an dernier, Dag Solstad, avec son roman Honte et dignité (traduit également par Jean-Baptiste Coursaud). Je sais qu’il a une grande renommée en Norvège. Pouvez-vous nous en dire quelques mots…
Vous êtes sûre que je l'ai cité ? (je lui montre la page…) Ah oui ! Je n’ai pas de relation particulière avec cet auteur sinon qu’il est mon voisin d’en face ! Bon… Il y a deux grands écrivains en Norvège, c’est Solstad et Jon Fosse.
Jean-Baptiste Courseau : J’ajoute que Solstad est le seul nobélisable. Quant à Jon Fose, c’est le dramaturge le plus joué en Europe. Mais on connaît mal Solstad parce que les éditeurs trouvent que ce qu’il écrit, c’est "trop norvégien", les Français n’y comprendraient rien…
Vous êtes vous-même dramaturge. En quoi cette activité littéraire influence-t-elle votre écriture romanesque ?
Je suis venu au théâtre par hasard. J’ai écrit ma première pièce après l’écriture du roman. Après cette pièce, on m’a proposé ce poste de dramaturge au théâtre national. Et l’écriture d’une pièce n’a changé en rien mon écriture romanesque. Si influence il y a c’est plutôt dans le sens inverse. On retrouve dans mes pièces de longs monologues. L’écriture des pièces est également très romanesque. Je pense que pour moi l’écriture de théâtre ça a davantage à voir avec le design. Quand vous êtes dramaturge, vous devez penser à tout un tas de paramètres différents. A savoir, est-ce que j’ai un metteur en scène, de la lumière, quels sont mes décors ? Autant de paramètres qui vont augmenter le coût de la pièce. Il faut être aussi vigilent à ça. Alors que lorsque j’écris un roman il n’y a que moi et le lecteur.
Mais en tant que dramaturge, vous continuez à écrire des romans ou c’est devenu votre activité exclusive ?
Non, en fait j’ai beaucoup travaillé pour le théâtre cette année puisque j’ai été dramaturge officiel du théâtre national d’Oslo. Il est probable que je continue encore un peu l’année prochaine mais ça s’arrête là. Je pense même que plus jamais je n’écrirai de théâtre de ma vie.
Ce n’était pas une bonne expérience ?
Ce qu’il faut savoir c’est qu’en Norvège, le monde du théâtre est un monde très vieillot, très suranné et moi je ne trouve pas ma place dans ce monde-là où tout est très bureaucratique. En fait, je suis ouvert à toute discipline artistique. Mais si je me rends compte que mon cœur n’est pas bien dans une discipline, ça ne me dérange pas du tout de l’abandonner. Mon cœur est auprès de la littérature.












 A
A
 L
L A
A

 V
V